Une idée d’éthique : défendre le droit des peuples à ne pas être dépossédés d’eux-mêmes
Dans la postface de l’édition française de L’Éthique de la liberté, l’économiste et philosophe Murra...
Dans la postface de l’édition française de L’Éthique de la liberté, l’économiste et philosophe Murra...
Bergère, guerrière, sainte — Jeanne d’Arc incarne la destinée héroïque par excellence. Elle est de...
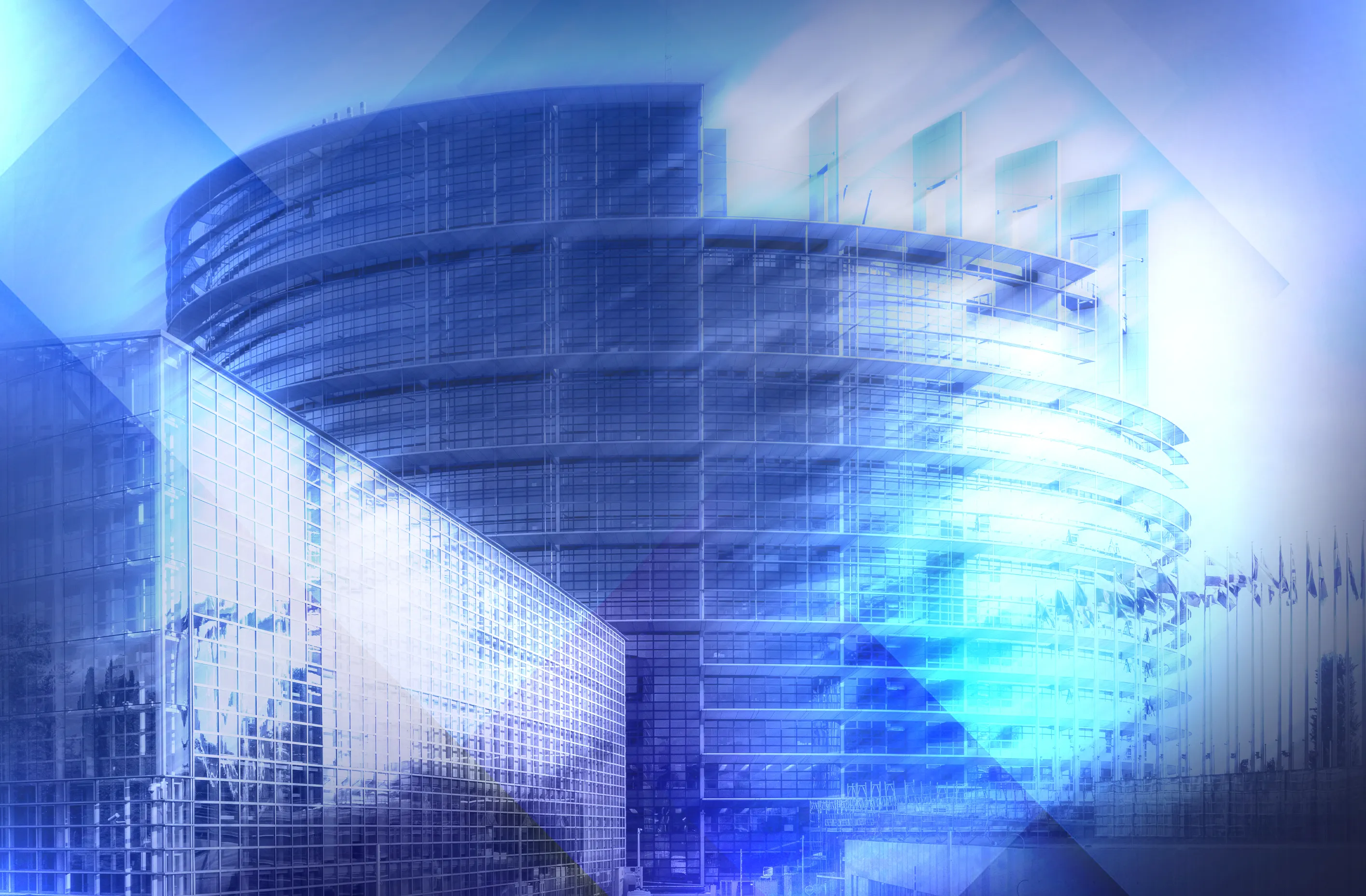


Plutôt que de subir la destruction créatrice, la France et l’Europe ont l’opportunité de l’organiser en un projet collectif où l’innovation devient synonyme de mobilité sociale et de renouveau économique. En conciliant compétitivité, formation et solidarité, elle peut faire de la transformation technologique un levier d’inclusion, et non un facteur supplémentaire de déclassement.
La destruction créatrice, concept de l’économiste autrichien Schumpeter, est souvent perçue dans une logique darwiniste : l’innovation bouleverse l’économie en éliminant les structures inadaptées et en redistribuant les cartes en faveur des pionniers technologiques. Pourtant, cette dynamique ne doit pas être synonyme d’exclusion sociale, marquée par des fermetures d’usines et des licenciements massifs. Bien encadrée, l’innovation peut au contraire devenir un levier de réintégration économique et de mobilité sociale pour ceux que la mondialisation a relégués aux marges du marché du travail.
L’enjeu est donc de transformer cette dynamique en opportunité collective. Comme le montrent Philippe Aghion, dans Le Pouvoir de la destruction créatrice, l’innovation ne produit pas uniquement des gagnants et des perdants : elle génère aussi de nouvelles opportunités pour les travailleurs modestes, à condition que les politiques publiques sachent les capter. Cette ambition repose sur trois axes fondamentaux : l’investissement dans le capital humain, la structuration d’une économie plus inclusive et un équilibre entre compétitivité et protections sociales.
L’un des principaux effets de la mondialisation a été de creuser l’écart entre une élite technologique et une main-d’œuvre fragilisée par l’automatisation. On connaît les grandes oppositions binaires : métropole/périphérie, anywhere/somewhere. Pourtant, l’innovation ne signifie pas nécessairement exclusion : elle peut aussi créer des perspectives de progression pour ceux qui occupent des emplois peu qualifiés.
Les entreprises innovantes ont démontré qu’elles valorisent les compétences spécifiques et investissent dans la montée en qualification de leurs employés, leur permettant d’évoluer au sein d’un secteur en mutation. L’enjeu n’est donc pas d’opposer innovation et protection des travailleurs, mais de garantir que l’accès à la formation et aux opportunités professionnelles accompagne les transformations économiques.
L’innovation ne doit pas être captée par une poignée d’acteurs privilégiés. L’enjeu est de structurer un écosystème productif qui diffuse les bénéfices de la transformation technologique à l’ensemble du tissu économique.
Le soutien à l’innovation ne doit pas se limiter aux grandes entreprises technologiques. Il est nécessaire de promouvoir des dispositifs fiscaux et financiers qui encouragent les entreprises à intégrer l’innovation sans pour autant sacrifier l’emploi. Des incitations doivent être mises en place pour favoriser l’émergence d’un tissu productif où les PME peuvent investir dans la montée en gamme et la modernisation de leurs processus, tout en maintenant une dynamique d’emploi accessible aux travailleurs moins qualifiés.
L’innovation tend à accroître les inégalités en haut de l’échelle des revenus, en concentrant les gains de productivité dans les mains des entreprises les plus performantes. Pourtant, cette dynamique est transitoire si elle s’accompagne d’un cadre institutionnel garantissant un rééquilibrage des opportunités.
La mise en place de dispositifs de “flexisécurité”, combinant protection sociale et transition professionnelle rapide, doit être une priorité. Ce modèle permettrait de limiter les effets négatifs de la destruction créatrice en offrant aux travailleurs affectés des filets de sécurité solides et un accompagnement vers des secteurs en expansion.
En parallèle, il est impératif de soutenir les entreprises qui s’engagent dans une logique d’inclusion, par le biais de politiques incitatives encourageant la formation et l’évolution interne des employés les moins qualifiés.
L’innovation ne doit pas être perçue comme un processus réservé à une élite déconnectée du reste de la société. Elle peut et doit être un outil de réindustrialisation, de montée en compétence et de création d’emplois accessibles à tous. Pour cela, les pouvoirs publics doivent orienter les transformations technologiques vers un modèle productif où la prospérité ne repose pas sur l’exclusion, mais sur la capacité à intégrer les laissés-pour-compte dans la dynamique de croissance.
Les économies anglo-saxonnes, où l’innovation se combine à une forte concentration des revenus, illustrent les risques d’un laissez-faire trop brutal. La France doit s’inspirer des stratégies qui favorisent la redistribution des opportunités, notamment par l’accès facilité à la formation continue et par l’incitation aux pratiques d’entreprises socialement responsables. Cela passe par une meilleure articulation entre innovation et politique éducative, afin que l’accès aux compétences ne soit pas réservé à une minorité.
Le modèle allemand du Mittelstand, où l’investissement en R&D est au cœur des stratégies des PME industrielles, offre un exemple pertinent. Contrairement aux approches exclusivement tournées vers la haute technologie, ce modèle repose sur une innovation ancrée dans les territoires et accessible à un large éventail d’acteurs économiques.
Le modèle scandinave, qui associe innovation intensive et forte mobilité sociale, prouve qu’il est possible d’innover tout en réduisant les inégalités. Des politiques publiques adaptées permettent de concilier innovation et réduction des inégalités, en instaurant des mécanismes de redistribution des gains de productivité vers l’ensemble des travailleurs.
Le soutien à l’économie de l’innovation exige également un engagement fort de l’État et des collectivités locales. Cela suppose une nouvelle approche de la gouvernance, avec des élus formés aux enjeux de l’innovation et attentifs à la valorisation des compétences nécessaires à cette transformation.
Il ne s’agit pas d’adopter une vision darwiniste de l’innovation, où seuls les plus forts survivent, mais d’y apposer un regard humaniste : un accompagnement des travailleurs, un respect des territoires et une ambition partagée pour le progrès.
L’innovation ne doit pas être le privilège d’une élite technologique déconnectée, ni un levier de domination économique. Elle doit permettre à des millions de travailleurs de retrouver un emploi valorisant, inscrit dans un projet collectif de progrès, leur offrant des perspectives d’avenir et la possibilité de mener une vie digne.
Newsletter